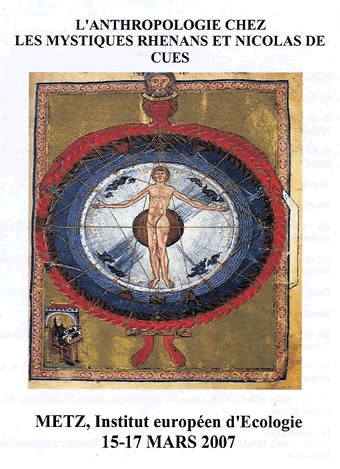
RÉSUMÉS DU COLLOQUE SUR L'ANTHROPOLOGIE CHEZ LES MYSTIQUES RHÉNANS ET NICOLAS DE CUES
(versions française et allemande)

Le rapport de l'homme à l'intellect subit un changement entre le IXème et le XVe siècle. Ce changement se décline en quatre composantes :
Dans la suite de l'exposé, au moyen de Jean Scot Erigène, Maître Eckhart et Nicolas de Cues, on montrera que :
1. Jean Scot Erigène
Pour Jean Scot Erigène, l’intellect n’est pas un don que l’homme a reçu de la nature, mais un présent de la grâce. L’intellect n’appartient pas à l’homme naturel. Cette définition de base amène à une définition dialectique de l’homme. Elle a sa racine dans la différence entre la nature humaine originelle ou restaurée et la nature humaine déchue. Elle peut être décrite en regardant le rapport de l’homme à l’ange. L’homme (déchu) n'est pour Jean Scot Erigène qu'un animal rationale sans intellect. L’ange au contraire, qui est doté d’intellect, est au sens propre imago Dei. En recevant l’intellect par grâce, l’homme est restauré égal à l’ange dans sa nature d'être spirituel. La transition de l’un à l’autre advient en passant par une docta ignorantia. Que le savoir humain soit un néant, cela ouvre la voie aux théophanies comme expression de l’intellect connaissant. De cette tension dialectique, suggérée par Erigène, entre théophanie et ignorance résulte la possibilité de la créativité humaine. Cette dernière est, bien sûr, pensée essentiellement dans une perspective eschatologique.
2. Maître Eckhart
Chez Maître Eckhart, le problème du néant gagne en précision. Ce n'est pas un hasard si la question du véritable détachement constitue le premier point du programme de prédication d’Eckhart. Alors que chez Erigène, le néant est plutôt une simple ligne de séparation entre l’homme et l’ange, il a chez Eckhart un domaine propre. L’homme « détaché » parvient au néant et doit alors trouver son « moi » dans la percée à travers le néant, en permettant la naissance de Dieu dans sa propre âme. L’intellect est en cela une puissance de l’âme, qui est donnée à chaque âme en tant qu'âme individuelle. En même temps, l’intellect est toutefois chez Eckhart une puissance détachée et pure. L’homme ne l'a donc que dans la mesure où il est vraiment détaché. En tant que l’intellect devient une puissance naturelle, qu’il s’agit d’acquérir par le détachement, la pensée d’une individualité propre gagne en importance après que l’homme se soit totalement détaché, sans que cela soit pensé d’un point de vue purement eschatologique.
3. Nicolas de Cues
Avec le Cusain, le rapport se déplace encore une fois. Pour lui aussi, comme pour Eckhart, l’intellect est un don naturel de l’homme. Mais dépassant Eckhart, Nicolas de Cues pense ce rapport au sens strict. Certes, lui aussi met en relief, comme Eckhart, le passage par le néant. Cependant, le but de cette percée n’est plus l'expérience spirituelle de la naissance de Dieu, mais la pure visio intellectualis. Elle est également détachée de toutes les choses sensibles, mais en même temps, elle n’est pas aussi, contrairement à Erigène, une rencontre directe avec un ange ou une naissance de Dieu dans l'âme comme chez Eckhart. Le Cusain maintient donc l’intellect dans le néant : il le sépare certes du monde ; cependant il ne contemple avec lui aucun être spirituel, ni Dieu ni l'ange (ce serait une vision mystica), mais les pures Idées. Bien sûr, il s’agit, lors de la visio intellectualis, d’une perception, et non de l'élaboration de notions abstraites. Du fait qu’elle demeure dans le néant même, elle n'est déterminée ni par le monde ni par Dieu et permet à l’homme de se réaliser librement lui-même.

L’influence de l’anthropologie d’Albert le Grand sur Maître Eckhart est considérable. L’expression d’âme noble (anima nobilis) que l’on retrouve chez Albert le Grand n’est pas sans rappeler un texte central de l’anthropologie eckhartienne : le Sermon sur l’homme noble. Chez Albert le Grand, la noblesse n’est pas à entendre exclusivement en tant que classe sociale, bien que le Colonais l’utilise en un tel sens afin d’expliquer l’ordonnance du corps à l’âme tel le sujet à son prince. Le champ lexical de la noblesse semble également signifier un autre sens, à la fois ontologique et noétique, celui de l’âme par laquelle l’homme peut s’unir à son Premier Principe, qu’on l’appelle Première Intelligence, Cause première ou encore Dieu. C’est à partir de la « noblesse » albertinienne que nous tenterons de donner quelques jalons rendant possibles une relecture du Sermon sur l’homme noble de Maître Eckhart.


Si Thomas d'Aquin a dialogué avec Maïmonide dans son oeuvre, Eckhart fait de même. Il le cite souvent, quelque quatre-vingt-cinq fois dans son Commentaire de l'Exode. L'ouvrage de Maïmonide auquel il se réfère explicitement est celui dont disposait tout théologien de l'époque : cette oeuvre majeure de la philosophie juive au Moyen-Âge qu'est le Guide des égarés. Ce livre aide Eckhart à approfondir le mystère de Dieu et la vie en Dieu. Mais, il n'en demeure pas moins que le Thuringien a été fortement marqué par l'exégèse de Maïmonide. Alors qu'il commentait la Genèse, il a trouvé chez Maïmonide une méthode et un questionnement qui lui permettaient d'aller plus loin dans la compréhension de l'Écriture. Ainsi a-t-il complété son Commentaire de la Genèse par un autre ouvrage : le Liber Parabolum Genesis, dont le titre est directement inspiré de Maïmonide et qui déploie toutes les ressources de l'allégorie. C'est une véritable rencontre de la philosophie et de la théologie juive et chrétienne au Moyen Âge qui se réalise là.

En tant qu’Il est de nature incréée, Dieu seul est capable de créer, c’est-à-dire de donner l’être. Principe des créatures, il est leur être par essence. L’essence incréée de Dieu conditionne la création. Or dans plusieurs sermons, Eckhart affirme que la créature est « un pur néant ». Si la créature n’a pas d’être en propre, son statut ontologique ne lui vient que de sa relation à Dieu : l’être créé est essentiellement esse ad. Son véritable esse est son être en Dieu. L’objectif du Maître est de montrer qu’en tant qu’elle se tourne vers Dieu et l’exprime, la créature est synonyme de plénitude. Mais si le geste créateur de Dieu constitue l’être créé, il est dans le même temps ce qui l’intègre dans une différence de nature. Le créé est ce qui « sort » du Principe incréé, et donc ce qui s’en sépare, quittant l’essentia incréée pour un simple esse. De cette séparation il ressort un vide, un néant qui, loin de signifier une coupure radicale du créé à l’incréé, ouvre la voie au désir du retour au Principe. Eckhart cherche donc comment penser la collatio esse après cette « sortie ». Pour ce faire, il interroge la relation du créé à l’incréé à partir de cette image divine déposée en l’âme, de ce « quelque chose au-dessus de la nature créée de l’âme ». Par l’Etwas in der Seele, un certain lien de connaturalité subsiste entre l’être créé et Dieu. Mais ce lien ne suffit pas à penser le retour au Principe. Eckhart s’interroge sur les enjeux mêmes de la constitution de l’être créé, et propose alors toute une anthropologie théologale à partir d’une mystique de l’être où la notion d’incréé occupe une place centrale. En renvoyant la création à la dynamique trinitaire, et en particulier au rôle du Fils au sein de la Trinité, Eckhart pense la constitution de l’être dans la voie d’une filiation divine : devenir fils dans le Fils apparaît alors comme un accomplissement pour l’homme. Car si Dieu s’est fait homme c’est pour que Dieu naisse dans l’âme et que l’âme naisse en Dieu. En partant du troisième point de son programme de prédication, Eckhart s’attache à montrer en quoi la réminiscence de l’incréé de l’âme est le point de départ d’une relation vivante de l’homme à Dieu parce qu’en elle s’accomplit la relation de donation ou la dynamique de la création nouvelle. Or cela suppose le moment essentiel du détachement. L’homme doit quitter sa condition créée et revenir à l’incréé en lui. Afin de laisser s’accomplir la grâce dans son âme, il doit alors pleinement consentir au don de Dieu, accueillant le travail du négatif comme l’œuvre d’abandon de son être naturel créé ; par là, il revient en son plus profond centre, en son être incréé, et se fait pleinement donataire de la grâce divine. L’incarnation du Fils trouve alors son motif dans la vie de l’âme selon son mode incréée, c’est-à-dire dans la naissance de Dieu dans l’âme, dans l’accomplissement de l’être créé par ce qu’il y a d’incréé en lui. Du créé à l’incréé s’opère ainsi un véritable chemin ontologique où se dessine l’anthropologie chrétienne du Maître. L’homme y apparaît comme un être de désir par où l’incréé coïncide avec son opposé, le créé, réalisant ainsi la dynamique de la donation comme faim de la Parole divine, celle même qui comble tout en laissant affamé. Ainsi l’incréé comme déconstruction du créé se pense à partir d’une théologie trinitaire où, à l’image du Fils, l’homme apprend à quitter son désir personnel, à le recentrer en Dieu, c’est-à-dire à ne faire que la volonté du Père pour que s’épanouisse l’Esprit d’amour. L’incréé n’est donc ni un lieu, ni un état ni même une valeur que l’homme pourrait habiter ou posséder, mais une absence même de qualités, un « néant » du plus intime et du plus profond de l’être, une faim comme béance de l’être et comme promesse de plénitude ontologique où l’homme devient par grâce ce que Dieu est par nature.


Pour la vie économique européenne, le XVe siècle constitue une époque charnière. C´est dans ce contexte que grandit et agit Nicolas de Cues. Ses origines et son parcours en sont profondément marqués. D´autre part, notamment par son intégration dans la vie intellectuelle italienne, Nicolas de Cues va intérioriser l´anthropologie aristotélicienne : l´homme est un « animal social » [Zoion politikón]. On voit que Nicolas de Cues désire restaurer l´unité, la justice et la paix dans l´Église et dans l´Empire comme il désire l´unité de l´esprit, de l´âme et du corps de l´homme. Pour lui, l´être humain s´épanouit en participant à l´œuvre du Créateur de manière organisée. Une hiérarchie fonctionnelle se justifie de par la diversité des talents humains. Elle ne s´oppose pas à l´égalité des droits naturels de chaque homme et doit être au service du Bien Commun. La hiérarchie sociale doit donc promouvoir des relations justes entre les hommes et les peuples, noble tâche pour un juriste comme lui. L´action de Nicolas de Cues correspond à son anthropologie. Il est travailleur, minutieux et persévérant. C´est un gestionnaire avisé comme le montrent par exemple le très rapide assainissement des finances de son diocèse et la bonne gestion de son patrimoine. En conclusion, Nicolas de Cues est un grand penseur médiéval. C´est aussi un humaniste dont l´anthropologie peut encore se révéler utile aujourd´hui pour analyser, juger et agir dans le domaine économique.
Dans son commentaire du morte morieris, Eckhart donne à ses considérations sur la mort une dimension éthique héritée d’Augustin aussi bien que du stoïcisme. Par conséquent, s’il n’ignore pas la mortalitas – qui s’incorpore à cette définition de l’homme comme animal rationale mortale –, il préfère cependant s’interroger sur la manière dont l’homme doit apprendre à vivre avec et quelle attitude il doit choisir en face d’elle. C’est pourquoi, reprenant Sénèques, Eckhart nous dit : « citius mori aut tardius ad rem non pertinet. Bene mori aut male ad rem pertinet ». Dès lors, nous analyserons les deux genres de morts qu’il décrit, ainsi que les deux modes de vie correspondants, et nous verrons comment l’homme peut se déterminer librement pour l’une ou pour l’autre au moyen de sa volonté. Cela aura pour but de montrer que chez le maître rhénan, la mors mystica s’inscrit dans une dialectique apologétique reposant sur son parallélisme antithétique avec la mors pessima : la première étant une mort au péché pour une vie en Dieu, la seconde une mort à Dieu pour une vie de péché loin de Dieu.
Maître Eckhart s'est efforcé de penser l'unité de l'être humain sans méconnaître pour autant la réalité multiple de celui-ci sur le plan anthropologique (les puissances) comme sur le plan existentiel (les modes de vie). L'exigence de l'Un référée au néoplatonisme se trouve projeté sur plusieurs niveaux d'intelligibilité : au niveau de la création avec une problématisation métaphysique (forme existante, espèce, essence/raison principielle), au niveau de l'adoption référée à l'Incarnation du Verbe avec la thématique de la filiation divine, au niveau du dynamisme de la percée avec la problématique du détachement. Dans cette recherche d'unification de l'existant humain s'opère la manifestation d'une dialectique de l'un et du multiple, déployée dans un langage multidimensionnel qui ne s'affranchit jamais de la préoccupation de la continuité de la Vie absolue de Dieu.
Freiheit ist ein zentraler Begriff der cusanischen Anthropologie. Cusanus hat diesen Begriff zuerst in einem kirchenpolitischen Kontext entwickelt; der für sein Werk De concordantia catholica charakteristische Gedanke, dass Herrschaft auf dem Konsens der Untergebenen beruht, setzt die Idee der Freiheit voraus. In seinen späteren Schriften hat Cusanus den Begriff der Freiheit in philosophischer und theologischer Hinsicht vertieft (Freiheit und Weltherrschaft, Freiheit als Gottessohnschaft). Der Vortrag schließt mit einem Blick auf den von Cusanus vor allem in seinen Predigten betonten Gedanken des Gehorsams. Es soll gezeigt werden, dass nach Cusanus der Gehorsam der Prüfstein wahrer menschlicher Freiheit ist.
These Das Verhältnis des Menschen zum Intellekt unterliegt zwischen dem 9. und dem 15. Jahrhundert einem Wandel. Dieser Wandel läßt sich anhand der vier Komponenten von
Im folgenden soll anhand von Johannes Scottus Eriugena, Meister Eckhart und Cusanus gezeigt werden, daß
Für Johannes Scottus Eriugena ist der Intellekt keine Gabe, die der Mensch von der Natur bekommen hat, sondern ein Geschenk aus Gnade. Der Intellekt gehört nicht zum natürlichen Menschen. Diese Grundbestimmung führt zu einer dialektischen Bestimmung des Menschen. Sie hat ihre Wurzel in der Differenz zwischen ursprünglicher bzw. wiederhergestellter und gefallener Menschennatur. Sie kann mit Blick auf das Verhältnis des Menschen zum Engel beschrieben werden. Der (gefallene) Mensch ist für Eriugena nur ein animal rationale ohne Intellekt. Der Engel hingegen, der über den Intellekt verfügt, ist im eigentlichen Sinne imago Dei. Indem der Mensch gnadenhaft den Intellekt erhält, wird er engelgleich und seiner Natur nach als geistiges Wesen wiederhergestellt. Der Übergang von einem zum anderen geschieht im Durchgang durch eine docta ignorantia. Daß das menschliche Wissen ein Nichts ist, öffnet den Blick für die Theophanien als Ausdruck des erkennenden Intellektes. Aus dieser von Eriugena angedeuteten dialektischen Spannung von Theophanie und Nichtwissen entspringt die Möglichkeit menschlicher Kreativität. Die Möglichkeit der Kreativität wird freilich wesentlich unter einer eschatologischen Perspektive gedacht.
2. Meister Eckhart
Bei Meister Eckhart nimmt das Problem des Nichts an Schärfe zu. Die Frage der rechten Abgeschiedenheit bildet nicht zufällig den ersten Punkt in Eckharts Predigtprogramm. Während bei Eriugena das Nichts eher eine bloße Trennlinie zwischen Mensch und Engel ist, erweitert es sich bei Eckhart zu einem eigenen Bereich. Der „gelassene“ Mensch dringt ins Nichts vor und muß sich dann im Durchbruch durch das Nichts das Ich erwerben, indem er die Gottesgeburt in der eigenen Seele zuläßt. Der Intellekt ist dabei eine Kraft der Seele, die jeder Seele als individueller Seele zukommt. Zugleich aber ist der Intellekt bei Eckhart eine abgeschiedene und reine Kraft. Der Mensch hat sie also nur, insoweit er wirklich abgeschieden ist. Indem der Intellekt zu einer natürlichen Kraft wird, die es aber zu erringen gilt qua Abgeschiedenheit, gewinnt der Gedanke einer geistigen Individualität nach allem Sich-Lassen der Person an Gewicht, indem er nicht rein eschatologisch gedacht wird.
3. Nikolaus von Kues
Mit Cusanus verschiebt sich das Verhältnis noch einmal. Auch für ihn ist wie für Eckhart der Intellekt eine Naturgabe des Menschen. Aber über Eckhart hinaus meint Cusanus dieses im strengen Sinne. Zwar betont auch er wie Eckhart den Durchgang durch das Nichts. Aber das Ziel dieses Durchbruchs ist nicht mehr eine geistige Erfahrung der Gottesgeburt, sondern die reine visio intellectualis. Sie ist gleichfalls abgeschieden von allen Sinnendingen, aber zugleich ist sie auch, anders als bei Eriugena, keine unmittelbare Begegnung mit einem Engel oder eine Gottesgeburt wie bei Eckhart. Cusanus hält also den Intellekt im Nichts: Er löst ihn zwar von der Welt, aber er betrachtet mit ihm kein Geistwesen, weder Gott noch Engel (das wäre eine visio mystica), sondern die reinen Ideen. Freilich handelt es sich bei der visio intellectualis um eine Schauen, es geht nicht um das Bilden von Abstraktionsbegriffen. Dadurch daß sie im Nichts selbst verbleibt, ist sie weder von der Welt noch von Gott determiniert und erlaubt dem Menschen eine kreative und freie Gestaltung seiner selbst.
Dr. rer. pol. Jean-Marie Fèvre, Dozent für Betriebswirtschaftslehre an der Paul Verlaine Universität Metz Das 15. Jahrhundert hat eine große Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Europas. In diesem Zusammenhang wächst und handelt Nikolaus von Kues. Seine Wurzeln und sein Werdegang werden davon tief geprägt. Andererseits wird Nikolaus von Kues –insbesondere durch seine Integration in die geistige Welt Italiens - das Menschenbild von Aristoteles verinnerlichen: Der Mensch ist ein soziales Wesen « Zoion politikón ». Man sieht, dass Nikolaus von Kues die Einheit, die Gerechtigkeit und den Frieden in der Kirche und im Reich wiederherstellen will. Er wünscht sich auch die Einheit des Geistes, der Seele und des Körpers des Menschen. Für ihn verwirklicht sich der Mensch, indem er am Werk des Schöpfers in geordneter Weise teilnimmt. Eine funktionelle Hierarchie rechtfertigt sich angesichts der Vielfalt menschlicher Fähigkeiten. Sie steht nicht im Gegensatz zur Gleichheit der natürlichen Rechte des einzelnen Menschen und soll dem Gemeinwohl dienen. Die gesellschaftliche Hierarchie soll also gerechte Beziehungen zwischen den Menschen und den Völkern fördern, eine edle Aufgabe für einen Juristen wie er. Nikolaus von Kues handelt gemäß seinem Menschenbild. Er ist fleißig, genau und beharrlich. Er ist ein umsichtiger Verwalter, wie es beispielsweise die schnelle Sanierung der Finanzen seines Bistums und die weise Handhabung seines Vermögens zeigen. Schließlich ist Nikolaus von Kues ein großer Denker des Mittelalters. Er ist auch ein Humanist, dessen Menschenbild sich heute noch als nützlich erweisen kann, um auf wirtschaftlichem Gebiet zu analysieren, zu beurteilen und zu handeln.
Eckharts Betrachtungen über den Tod in seinem Kommentar über das morte morieris haben eine auf Augustinus und den Stoizismus zurückgehende ethische Dimension. Folglich widmet er sich mehr den Fragen, wie der Mensch lernen soll, mit der mortalitas zu leben, und welche Einstellung er ihr gegenüber einzunehmen hat, als der mortalitas an sich – auch wenn er diese, der Definition vom Menschen als animal rationale mortale implizit, nicht ignoriert. Daher schreibt er in Anlehnung an Seneca: „citius mori aut tardius ad rem non pertinet. Bene mori aut male ad rem pertinet“. In diesem Kontext gilt es, die zwei Arten des Todes, die Eckhart hier erwähnt, sowie die zwei entsprechenden Lebensweisen zu analysieren, um zu sehen, wie der Mensch sich aufgrund seines Willen in beide Richtungen frei entscheiden kann. Es soll gezeigt werden, dass sich die mors mystica bei Eckhart in eine apologetische Dialektik einschreibt, die auf ihrem antithetischen Parallelismus mit der mors pessima basiert.
14.3. 2007 : Eckhart et la mystique rhénane (ISR Nancy).
24.3.2007 : Organisation de la journée Eckhart au Centre d'études du Saulchoir et conférence.
13.9.2007 : De visione Dei von Nikolaus von Kues (Bernkastel, Tagung)
20-22.9.2007 : Le mystère pascal chez Eckhart (Albertinum, Fribourg).
16.1.2008 : Mystique chrétienne et métaphysique chez Eckhart (Reims, Bibliothèque Carnégie).
Jean Devriendt
24 .3. 2007 journée Eckhart au Centre d'études du Saulchoir, Paris , “Introduction à la pensée de Me Eckhart”.
L’actualité de Maître Eckhart, « Les vivants et les dieux », France Culture, Michel Cazenave, Février 2007.
Exposition sur Nicolas de Cues, Metz, 15.3-15.4.2007.
Lire le rapport d’activités…/2007/RAPPORT.html
12.11.2007 :
La théorie du Fluxus chez Albert le Grand : principes philosophiques et applications théologiques : le De fluxu causatorum a causa prima et causarum ordine : introduction, texte, traduction, notes et commentaire.
Thèse en cotutelle